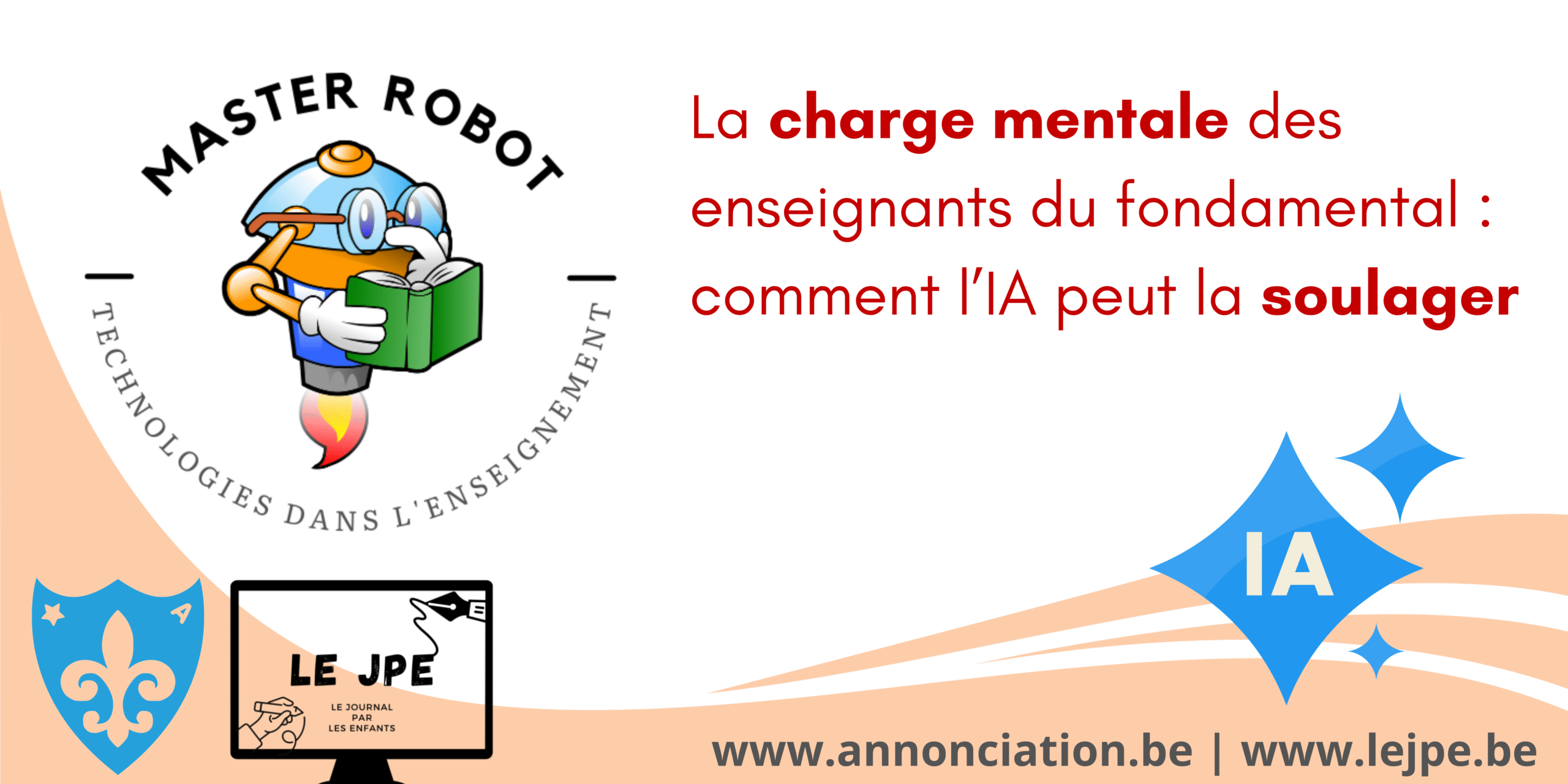
Un métier sous une pression grandissante
« On est tellement pris par de l’administratif, par de la gestion et toute autre chose que du pédagogique, qu’il n’est plus possible de faire un travail correct » témoigne une institutrice de primaire, épuisée par des journées à rallonge (RTBF, 2023). Son cri du cœur illustre un mal-être devenu chronique dans l’enseignement fondamental en Belgique francophone. D’après une enquête internationale récente, 67 % des enseignants belges francophones ont jugé leur dernière année scolaire « excessivement stressante », et 59 % évoquent un déséquilibre structurel entre vie professionnelle et vie privée (Réseau Éducation & Solidarité, 2024). Plus alarmant encore, 41 % des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles ne referaient plus ce métier s’ils avaient le choix (Réseau Éducation & Solidarité, 2024). Ces chiffres traduisent une réalité : la charge mentale des instituteurs s’alourdit au fil des réformes et des contraintes, au point de menacer l’attractivité du métier et la santé de ceux qui l’exercent.
Quelles sont les sources de cette surcharge ? Sur le terrain, les enseignants décrivent une véritable « accumulation » des tâches. « Chaque année on recommence avec de nouveaux élèves, de nouvelles classes. J’observe aussi que de nombreuses tâches viennent se rajouter : tâches administratives (dossiers d’élèves, PIA…), mise en place d’activités diverses liées aux nouveaux défis de l’enseignement (cellule de prise en charge du harcèlement, élèves à besoins spécifiques, élaboration du plan de pilotage…). Ce sont toujours des tâches supplémentaires qui s’ajoutent au travail d’enseignement » (CSC-Enseignement, 2024). Effectivement, le temps passé à enseigner devant les élèves ne constitue qu’environ la moitié du travail réel : « l’avis 3 du Pacte d’Excellence considère que cela représente un peu plus de la moitié de la charge totale » (Pacte d’Excellence, FWB, 2016). Tout le reste se déroule en coulisses, dans l’ombre des classes : préparation des leçons, corrections, formulaires à remplir, réunions d’équipe, sans oublier les mille imprévus du quotidien.
Parmi les causes principales de cette charge mentale, la paperasse administrative arrive en bonne place. Bulletins, journal de classe numérique, statistiques, PV : les professeurs passent de longues heures sur ces tâches bureaucratiques au détriment de leur cœur de métier. En avril 2023, leur ras-le-bol a éclaté au grand jour : « Plus de 4 000 enseignants belges ont manifesté (…) pour dénoncer la surcharge de travail administratif qui met à mal leur métier d’enseignant » (RTBF, 27/04/2023).
Autre fardeau : l’accompagnement des élèves à besoins spécifiques. L’école inclusive est un progrès humain, mais elle implique pour l’enseignant de différencier sans cesse son approche, de remplir des PIA et d’assurer un suivi personnalisé, souvent sans moyens ni formation. Une seule classe peut réunir 20 ou 25 enfants aux profils très variés (dyslexie, trouble de l’attention, handicap, primo-arrivants…), ce qui exige du sur-mesure quotidien.
S’ajoutent à cela les exigences liées au « contrat d’objectifs » mis en place par le Pacte pour un Enseignement d’excellence. Chaque école doit désormais élaborer un plan de pilotage – une feuille de route stratégique sur six ans – et atteindre des cibles en matière de réussite, d’équité, etc. Cela se traduit pour les enseignants par des réunions supplémentaires et une pression accrue sur les résultats. Beaucoup dénoncent une dérive managériale : « Les promesses de management participatif tant vantées ne semblent guère suivies d’effet : les enseignants belges sont les plus nombreux (50 %) à déclarer que la majorité des décisions importantes de l’école se prennent sans eux » (Réseau Éducation & Solidarité, 2024).
La culture de l’évaluation généralisée pèse également : on évalue non seulement les élèves, mais aussi les enseignants et les écoles. « La question de l’évaluation des enseignants sur leurs aptitudes pédagogiques, liée au Pacte d’excellence, était également au cœur de cette manifestation » (RTBF, 2023).
Enfin, l’introduction du nouveau tronc commun constitue un défi supplémentaire. Assimiler de nouveaux référentiels et adapter ses pratiques en un temps record a été source de stress. Dès la rentrée 2022, l’entrée en vigueur des premières mesures du Pacte s’est accompagnée d’une impression de surcharge et d’un manque de formation suffisante (Ligue de l’enseignement, 2022).
L’IA générative, un allié pour soulager le fardeau
Face à ce constat, une lueur d’espoir pourrait venir d’un domaine inattendu : l’intelligence artificielle générative (IAg). Ces outils (tels que ChatGPT ou Gemini) sont capables de produire des textes, des images, du code, sur simple requête en langage naturel. Utilisés de manière réfléchie, ils offrent une opportunité de soulager les enseignants en automatisant ou allégeant certaines tâches cognitives lourdes. D’après un guide officiel québécois, « l’IA peut assister l’enseignant dans la réalisation de certaines tâches, ce qui peut réduire sa charge de travail et lui permettre d’avoir plus de temps pour se consacrer à d’autres tâches plus signifiantes » (Ministère de l’Éducation du Québec, 2023).
Quelques exemples concrets :
- Préparation des cours : générer des idées d’activités, des plans de leçon ou des questionnaires en quelques secondes.
- Différenciation pédagogique : reformuler un énoncé en langage plus simple, créer plusieurs versions d’un même exercice, ou proposer des supports adaptés aux élèves à besoins spécifiques.
- Adaptation des supports : traduire un document pour un parent allophone, simplifier un texte pour un élève en difficulté, générer une illustration adaptée.
- Suivi et évaluation : produire des commentaires de bulletin à partir de quelques notes, analyser rapidement les difficultés communes dans une évaluation.
- Communication : rédiger un courrier aux parents, un compte-rendu de réunion ou synthétiser un document officiel.
Comme le rappelle un entretien mené par l’ONU, « l’IA facilite l’automatisation des tâches administratives, ce qui libère du temps aux enseignants » (UNRIC, 2023).
Un usage raisonné et éthique
Bien sûr, l’IA n’est pas une baguette magique. Elle peut se tromper (hallucinations), renforcer des stéréotypes, ou poser des questions de confidentialité (données élèves). Elle ne doit pas remplacer le jugement pédagogique ni l’interaction humaine.
👉 Mise en garde essentielle : l’IA n’est pas là pour « faire à la place » de l’enseignant. Celui-ci reste l’acteur principal, le décisionnaire et l’expert pédagogique. L’IA n’est qu’un outil d’appui, un assistant virtuel qui propose, suggère, automatise certaines tâches, mais ne peut ni décider ni créer du lien éducatif. C’est toujours à l’enseignant qu’il revient de valider, d’adapter et d’incarner la pédagogie auprès de ses élèves.
Comme le rappelle un expert, « l’IA n’est pas là pour remplacer les enseignants, mais pour les épauler et enrichir leurs pratiques » (UNRIC, 2023). L’enjeu est de l’intégrer avec discernement, dans un cadre éthique clair, et avec une formation adaptée.
Recentrer l’enseignant sur l’essentiel
Moins de corvées administratives, plus de temps pour enseigner : n’est-ce pas ce que réclamaient les milliers d’enseignants dans la rue ? L’IA, loin d’être une menace, peut devenir une alliée précieuse pour dégager du temps et de l’énergie. Du temps pour innover, écouter un élève, créer du matériel original – bref, pour retrouver le cœur du métier.
En libérant les profs d’une partie de leur charge mentale, on leur permet de se recentrer sur leur mission première : former des esprits, éveiller des vocations, accompagner chaque enfant dans son développement. Autrement dit, libérer du temps pour l’essentiel — la relation humaine, la pédagogie, la créativité.
