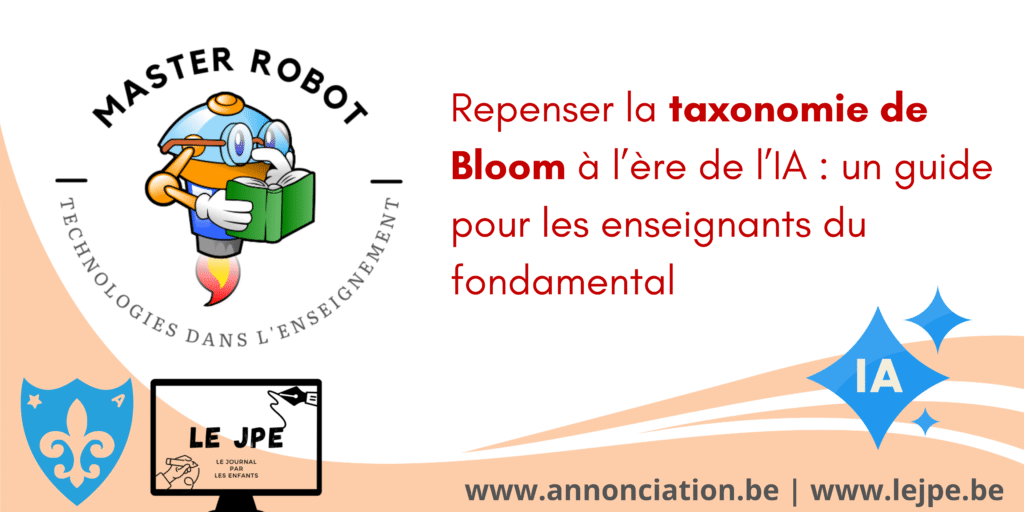
Auteur

Un enseignant passionné par le numérique
Je m’appelle Vincent Backeljau, et je suis enseignant en 5e et 6e primaire à l’Institut de l’Annonciation, à Schaerbeek. En tant que référent numérique de mon école, j’ai à cœur de partager mon expérience et mes découvertes avec d’autres enseignants.
Mon objectif est de fournir des ressources concrètes et adaptées, permettant à chaque enseignant d’intégrer les technologies dans ses pratiques, tout en valorisant une approche pédagogique équilibrée, ouverte à tous les outils, qu’ils soient libres ou propriétaires.
Introduction
L’arrivée de l’intelligence artificielle générative (IAg) dans le monde scolaire pose une question essentielle : quelles tâches doivent rester humaines et lesquelles peuvent être soutenues par l’IA sans compromettre l’apprentissage ?
Pour nous aider à clarifier cette frontière, l’Université d’État de l’Oregon (Oregon State University) a revisité la taxonomie de Bloom et l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en a proposé une adaptation en français. Cet outil, loin d’être réservé au supérieur, peut devenir un repère précieux pour les enseignants du fondamental, du cycle 1 au cycle 4.
Source : https://collimateur.uqam.ca/a-la-une/la-taxonomie-de-bloom-revisitee-a-lere-de-lia/
Pourquoi revisiter Bloom avec l’IA ?
La taxonomie de Bloom décrit depuis longtemps les étapes de l’apprentissage : mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer. Or, l’IA est aujourd’hui capable d’intervenir dans chacune de ces étapes : elle peut résumer, comparer, traduire, mais aussi générer du texte, des images ou des idées.
Le risque est clair : si nous ne redéfinissons pas qui fait quoi, l’IA pourrait occuper une place qui ne revient pas à la machine. Revisiter Bloom permet de préserver la valeur des apprentissages humains tout en utilisant l’IA comme levier, au bon endroit.
Ce que propose la taxonomie revisitée
Le tableau issu des travaux d’Oregon State et de l’UQAM met en évidence une répartition claire des rôles :
- Mémoriser
- IA : rappeler, énumérer, traduire.
- Élève : mobiliser la mémoire sans aide, automatiser les bases.
- Comprendre
- IA : reformuler, illustrer, donner des exemples.
- Élève : contextualiser, relier aux expériences vécues, saisir le sens profond.
- Appliquer
- IA : suggérer des démarches, fournir des cas-types.
- Élève : agir, manipuler, adapter la démarche aux contraintes réelles.
- Analyser
- IA : comparer, détecter des tendances, organiser des données.
- Élève : justifier, argumenter, exercer le raisonnement critique.
- Évaluer
- IA : produire des grilles de critères, proposer des points de vérification.
- Élève : prendre position, défendre un choix, assumer une responsabilité éthique.
- Créer
- IA : offrir un support d’idéation, générer des alternatives.
- Élève : produire une œuvre originale, assumer le style, donner une cohérence.
Comment utiliser ce cadre dans le fondamental ?
Cette grille n’est pas une recette, mais un outil de réflexion. Elle aide l’enseignant à se poser la question, à chaque activité :
- Quel est l’objectif d’apprentissage visé ?
- Quelle part de l’activité peut être soutenue par l’IA ?
- Quelle part doit absolument rester humaine ?
Quelques exemples concrets d’intégration :
- Cycle 1 (maternelles) : l’IA peut aider l’enseignant à générer des images ou histoires pour illustrer un conte (soutien au niveau comprendre), mais la narration, l’écoute et la mise en scène restent le rôle des élèves.
- Cycle 2 (1ᵉ et 2ᵉ primaires) : l’IA peut reformuler un texte pour le simplifier (soutien au comprendre), mais l’élève doit raconter l’histoire avec ses mots (création orale).
- Cycle 3 (3ᵉ et 4ᵉ primaires) : l’IA peut comparer deux sources d’information (soutien au analyser), mais c’est à l’élève de tirer une conclusion personnelle.
- Cycle 4 (5ᵉ et 6ᵉ primaires) : l’IA peut suggérer des arguments pro/contra (soutien au évaluer), mais le jugement final et la défense d’une position restent humains.
Relier Bloom aux pratiques de classe
En utilisant cette grille, j’ai pris l’habitude de préciser dans mes consignes :
- à quel niveau de Bloom je situe mon activité,
- et dans quelle mesure l’IA est autorisée ou non.
Cela permet d’aligner plus finement mes objectifs avec l’usage de l’IA et de clarifier les attentes auprès des élèves.
Combinée aux pictogrammes de déclaration d’usage de l’IA, cette démarche devient un véritable outil de transparence et d’éthique pédagogique.
Les bénéfices pour les enseignants
Adopter la taxonomie revisitée, c’est :
- mieux cibler les apprentissages : l’IA n’est pas un raccourci mais un outil ;
- éviter la confusion des rôles : l’élève comprend ce qui lui revient en propre ;
- intégrer l’IA sans dénaturer : les activités restent porteuses de sens et d’humanité ;
- favoriser l’innovation pédagogique : en exploitant le potentiel de l’IA pour stimuler, clarifier et enrichir.
Conclusion
La taxonomie de Bloom revisitée à l’ère de l’IA n’est pas un modèle théorique de plus. C’est un guide pratique qui aide chaque enseignant à poser des choix clairs dans la conception d’activités.
L’enjeu est simple : ne pas laisser l’IA décider pour nous. Elle peut analyser, comparer, proposer ; mais créer, juger et contextualiser resteront toujours le cœur de notre mission éducative.
👉 Je vous invite à explorer l’infographie de l’UQAM, à la mettre dans vos salles des maîtres, et à l’utiliser comme boussole dans vos prochaines préparations. Vous verrez qu’elle offre un cadre rassurant et stimulant pour naviguer avec vos élèves dans l’ère de l’intelligence artificielle.
